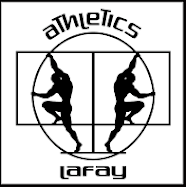On nous dit que les libéraux (néolibéraux, whatever) sont politiquement morts, dépassés, sans appui populaire. Et pourtant, tous les maux du monde seraient causés par eux. À ce stade, on a les libéraux de Schrödinger : absents des urnes, mais omniprésents dans les cerveaux.
— Vincent Geloso (@VincentGeloso) July 21, 2025
Schrödinger's Geageaists pic.twitter.com/G85kuTOHhh
— John Gotti (@The_Dapper_Don1) July 15, 2025
« Si les libéraux sont vraiment finis, pourquoi continue-t-on à les accuser de tout ? »
Le tweet utilise l’ironie et la métaphore du chat de Schrödinger pour souligner une contradiction : on affirme que les libéraux (ou néolibéraux) sont morts politiquement, sans soutien électoral, mais on continue à les accuser d’être la cause de tous les problèmes. L’auteur critique cette incohérence : si leur influence est vraiment finie, pourquoi leur accorder autant de place dans les débats ?
ChatGPT
1. Les Lumières en France – bref rappel
Le mouvement des Lumières en France (XVIIIe siècle) fut un courant intellectuel majeur marqué par :
- la valorisation de la raison et de la science,
- la critique des dogmes religieux et de l’absolutisme,
- une défense des libertés individuelles, de la tolérance, et du progrès humain.
Il est porté par des figures comme Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, etc.
—
2. Et au Québec ?
Le Québec (ou plus précisément, le Bas-Canada, alors colonie française jusqu’à 1763, puis britannique) n’a pas connu un mouvement des Lumières aussi structuré que la France. Cependant, plusieurs éléments montrent une forme propre de « Lumières canadiennes-françaises », quoique plus modérées et teintées par le contexte local.
a. Contexte limitant
- Le clergé catholique y gardait une forte emprise sur l’éducation, la morale et la culture.
- L’absence d’universités ou d’imprimeries libres jusqu’au XIXe siècle a freiné la circulation d’idées critiques.
- L’influence des autorités coloniales britanniques après 1763 a aussi limité certaines libertés intellectuelles.
b. Présence d’esprits éclairés
Quelques figures ont tout de même porté des idées rationalistes, libérales ou critiques, parfois en lien avec les Lumières européennes :
- Pierre du Calvet (1735–1786) : défenseur des droits civiques et de la liberté.
- Fleury Mesplet : imprimeur des Gazettes de Montréal, influencé par les Lumières, emprisonné pour ses idées.
- Valentin Jautard : avocat et journaliste, très francophile et partisan de la liberté d’expression.
Ils sont rares, mais symbolisent une émergence de pensée critique dans un contexte conservateur.
—
3. Une forme québécoise de Lumières ?
On pourrait dire que les « Lumières » québécoises ont été :
- plus tardives, plus diffuses, moins radicales que celles de la France,
- souvent freinées par le cléricalisme, mais pas inexistantes,
- réactivées plus tard avec la Révolution tranquille dans les années 1960, qu’on pourrait presque voir comme une forme de »seconde Lumière » québécoise – cette fois massive, laïque, modernisatrice.
—
🔎 Conclusion
Le Québec n’a pas eu un âge des Lumières aussi affirmé que la France au XVIIIe siècle, mais des germes d’esprit éclairé étaient présents chez certains penseurs, et les grands idéaux de raison et de liberté ont fini par s’exprimer au fil de son histoire, notamment au XXe siècle. On peut parler d’un cheminement différé, sous contraintes, mais réel.
ChatGPT
__________Friedrich Hayek avait une opinion nuancée des Lumières. Il ne rejetait pas entièrement ce mouvement intellectuel, mais il distinguait clairement deux courants opposés au sein des Lumières, et critiquait fortement l’un des deux.
🌟 1. Les deux Lumières selon Hayek
Hayek, dans plusieurs de ses écrits (notamment The Counter-Revolution of Science et Droit, législation et liberté), distinguait :
🟩 Les Lumières anglaises ou écossaises
- Adam Smith, David Hume, Edmund Burke, etc.
- Fondées sur un évolutionnisme spontané : les institutions sociales (droit, marché, morale) émergent par essais, erreurs et traditions, non par un plan rationnel.
- Valorisaient la limitation du pouvoir de l’État, la liberté individuelle, et le respect de l’ordre spontané.
- Hayek s’identifiait pleinement à ce courant.
🟥 Les Lumières françaises (ou “rationalistes”)
- Voltaire, Rousseau, Diderot, Condorcet, etc.
- Fondées sur l’idée que la raison humaine peut tout planifier : société, économie, éducation.
- Ont inspiré des visions constructivistes de la société : le monde social doit être façonné rationnellement selon un modèle.
- Hayek critiquait vivement ce courant, qu’il jugeait dangereux, à l’origine de nombreux totalitarismes modernes (communisme, fascisme, etc.).
—
💬 Ce que Hayek en disait
Dans The Counter-Revolution of Science (1952) :
« Ce qui est si préoccupant, c’est que le rationalisme constructiviste français ait supplanté l’évolutionnisme humble de la tradition anglo-saxonne. »
Il reprochait aux Lumières françaises d’avoir semé les graines de la croyance en un État tout-puissant capable de redessiner la société – une idée qu’il jugeait contraire à la liberté et vouée à l’échec.
—
✅ Résumé
Hayek n’était pas contre les Lumières, mais il admirait la branche anglo-écossaise, prudente et empirique, et s’opposait fermement à la branche française, jugée arrogante et dangereusement centralisatrice.
ChatGPT
Paris Ville Lumière ! https://t.co/ok0ihjcGjQ
— SILVANO TROTTA OFFICIEL (@silvano_trotta) July 22, 2025