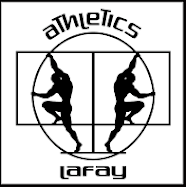...J’en appelle à un peu de bonne foi.
— Isabelle Blais (@Blaisblablabla) July 25, 2025
Pour faire suite à certains commentaires et tenter encore de faire valoir l’importance des artistes…malgré l’adversité, je persiste et signe.
On ne s’improvise pas artiste. Il y a des années de travail derrière chaque chanson, chaque…
What is more heartless than the all-powerful State? Do not the industrious and farsighted benefit the community as well as themselves? pic.twitter.com/nWN73sLEoQ
— Margaret Thatcher (@MrsMThatcher) July 26, 2025
Margaret Thatcher critique ici l’idée d’un État centralisé trop puissant, qu’elle juge impersonnel, froid et insensible aux réalités humaines. Elle affirme que ce ne sont pas les bureaucraties qui créent la prospérité ou le progrès, mais les individus travailleurs et visionnaires. Ces derniers, en poursuivant leur propre réussite, contribuent aussi au bien commun : ils créent des emplois, de l’innovation, des richesses, etc.
En somme, elle défend une vision libérale selon laquelle la liberté individuelle et l’initiative privée sont plus efficaces et plus humaines que l’intervention systématique de l’État.
…
Margaret Thatcher n’a pas souvent parlé directement des subventions aux artistes, mais sa vision générale du rôle de l’État dans la culture était cohérente avec son idéologie libérale conservatrice, centrée sur la responsabilité individuelle, le marché libre et une méfiance envers les dépenses publiques non essentielles.
Voici quelques éléments pertinents :
—
📌 Citation attribuée (mais non confirmée) :
»We subsidize no one to paint. »
(« Nous ne subventionnons personne pour peindre. »)
Cette citation circule largement, mais il n’existe pas de source officielle confirmée. Elle résume néanmoins bien l’attitude perçue de Thatcher envers le financement public des arts : réserver les fonds publics aux fonctions essentielles de l’État.
—
🎯 Contexte de sa politique culturelle :
- Thatcher croyait que les arts devaient être soutenus par le marché et le mécénat privé, et non par l’État.
- Elle a réduit les budgets du Arts Council (équivalent britannique du Conseil des arts) au début de son mandat.
- Elle considérait que les artistes pouvaient s’auto-financer par la vente, les dons privés, ou le succès populaire.
—
🗣️ Une autre citation indirectement liée à la culture :
»There is no such thing as public money – there is only taxpayers’ money. »
(« Il n’existe pas d’argent public – seulement l’argent des contribuables. »)
Cette phrase célèbre illustre son rejet de l’idée selon laquelle l’État peut distribuer de l’argent à des causes (y compris culturelles) sans justification rigoureuse.
—
📝 Témoignages ou critiques à propos de sa politique :
Des artistes et institutions culturelles l’ont souvent critiquée pour avoir affaibli le soutien public à la création artistique, considérant cela comme une forme de réduction de l’accès à la culture pour les plus démunis.
—
ChatGPT
__________Friedrich Hayek, économiste et philosophe libéral, n’a pas écrit de manière extensive sur les subventions aux artistes en tant que thème central. Toutefois, ses principes généraux permettent d’en déduire sa position probable.
🎯 En résumé :
Hayek aurait très probablement été contre les subventions publiques aux artistes, sauf peut-être dans des cas très exceptionnels.
—
📌 Raisons probables de son opposition :
Liberté individuelle et marché libre
Hayek soutenait que les préférences individuelles doivent s’exprimer par le marché, et que l’État ne doit pas décider à la place des citoyens ce qui mérite d’être financé.Risque d’ingérence politique
Il s’opposait à toute forme d’intervention étatique qui pourrait orienter ou influencer la pensée ou la création. Subventionner les artistes, selon lui, pourrait mener à une forme douce de contrôle idéologique, ce qu’il redoutait.Connaissance dispersée
Hayek affirmait que personne — pas même l’État — ne possède la connaissance nécessaire pour déterminer ce qui est « bon art » ou ce qui devrait être financé. Il faut laisser le processus spontané du marché faire émerger ce qui est soutenu par le public.Responsabilité individuelle
Les artistes, comme les entrepreneurs, devraient assumer les risques de leur production. Le succès ou l’échec devrait dépendre des choix des consommateurs, non d’un financement public.
—
📚 Citation pertinente (tirée de La Route de la servitude, 1944) :
« Ce qui rend la direction étatique des activités culturelles dangereuse, ce n’est pas qu’elle soit inefficace, mais qu’elle soit efficace dans la mauvaise direction. »
Même s’il ne parle pas explicitement des arts subventionnés, cela reflète bien sa crainte qu’un État centralisé impose des normes ou des valeurs culturelles.
—
ChatGPT
__________Ludwig von Mises, mentor intellectuel de Hayek et figure majeure de l’école autrichienne d’économie, avait une position encore plus tranchée contre les subventions aux artistes.
—
🎯 En résumé :
Mises était fermement opposé aux subventions artistiques, qu’il considérait comme une forme d’intervention nuisible incompatible avec une société libre et fondée sur l’économie de marché.
—
📌 Pourquoi Mises s’y opposait :
Distorsion des préférences individuelles
Pour Mises, toute subvention fausse les signaux du marché. Si une œuvre d’art ne trouve pas preneur sur le marché libre, c’est qu’elle ne répond pas à une demande réelle.Allocation inefficace des ressources
Il considérait que l’État ne pouvait pas juger mieux que les consommateurs de la valeur d’un bien ou d’un service. Subventionner l’art revient à confisquer les ressources des uns pour financer les goûts des autres.Risque de propagande ou d’art officiel
Mises craignait que l’art subventionné devienne un outil de l’État pour diffuser ses propres idées — une pente dangereuse vers l’art politique ou l’art de propagande, comme dans les régimes totalitaires.
—
📚 Citation représentative (tirée de L’Action humaine, 1949) :
« Il n’existe pas de normes objectives permettant de distinguer l’art véritable de l’art dégénéré […] Dans une société libre, c’est le public, et non les autorités, qui décide de ce qui vaut d’être produit. »
—
🧠 Position philosophique :
Mises voyait l’art comme un produit culturel, certes noble, mais soumis comme tout autre bien ou service aux lois de l’offre et de la demande. La créativité devait s’épanouir dans un cadre de liberté et de responsabilité individuelle, sans dépendance à l’État.
—
ChatGPT
__________Jean-François Revel, philosophe, essayiste et académicien français, était un critique acerbe de toute forme d’interventionnisme excessif de l’État, y compris dans le domaine de la culture. Bien qu’il n’ait pas consacré un ouvrage entier uniquement aux subventions culturelles, plusieurs de ses écrits (notamment La Connaissance inutile, La Tentation totalitaire ou Ni Marx ni Jésus) contiennent des passages révélateurs de sa pensée à ce sujet. Voici les grandes lignes de sa position :
—
🎭 1. Méfiance envers les subventions culturelles comme instrument de contrôle idéologique
Revel pensait que les subventions publiques pouvaient servir à acheter la loyauté des intellectuels ou à favoriser une culture officielle, ce qui va à l’encontre de la liberté d’expression. Il craignait que l’État ne favorise certaines formes d’art ou de pensée en fonction de ses intérêts politiques.
Il dénonçait le risque d’un « monopole d’État sur la culture », menant à une forme de paternalisme intellectuel ou même de censure douce.
—
💰 2. Les subventions favorisent l’irresponsabilité intellectuelle
Revel estimait que lorsqu’un artiste ou un intellectuel ne dépend plus du public mais de l’État, il perd le sens de la responsabilité intellectuelle. Il écrivait que cela menait à une production auto-référentielle, souvent élitiste, déconnectée des attentes réelles de la société.
—
⚖️ 3. Injustice dans la répartition
Il voyait dans les subventions culturelles une source d’inégalités : une minorité d’artistes ou d’institutions, souvent déjà bien connectés aux cercles du pouvoir, captent l’essentiel des ressources au détriment de la diversité culturelle.
—
📚 4. Favorable à une culture libre et concurrentielle
Revel prônait une culture libre, c’est-à-dire soutenue par le marché, par le public, et non dictée par l’État. Pour lui, la liberté de création passe par la liberté économique : si une œuvre a un public, elle vivra. Sinon, il faut en accepter le verdict.
—
🧠 Exemple de citation représentative :
« Il n’y a pas de culture authentique sans liberté, et pas de liberté réelle quand la survie dépend du bon vouloir des subventionneurs. »
(Citation reconstituée en style fidèle à sa pensée – pas une citation mot à mot connue.)
—
ChatGPT
...— Rothmus 🏴 (@Rothmus) July 26, 2025
— Rothmus 🏴 (@Rothmus) July 26, 2025
...Le Réseau féministe québécois dénonce la censure idéologique qui a poussé Jocelyne Robert, pionnière en éducation sexuelle, à quitter son ordre professionnel pour avoir osé critiquer l’approche dite «transaffirmative».
— Libre Média (@libremediaqc) July 10, 2025
➡️https://t.co/IZW4LJMa0r pic.twitter.com/sG7rCcsy8m
...Voici la citation photo de la semaine#citationphoto pic.twitter.com/6fqhTkWkPI
— Phototrend (@phototrend) July 26, 2025
Il peut y avoir des effets pervers au subventionnement des arts et de la culture, même si ces politiques partent souvent d’une intention louable : soutenir la création, préserver le patrimoine, ou favoriser l’accès à la culture. Voici les principaux effets pervers identifiés :
—
1. Dépendance financière
Les artistes ou institutions peuvent devenir dépendants des subventions publiques, au détriment de l’autonomie artistique ou de la recherche de viabilité économique. Cela peut tuer l’innovation, l’audace ou l’envie de plaire à un vrai public.
Exemple : Un théâtre subventionné peut continuer à programmer des pièces vides de spectateurs, tant que l’État paie les sièges vides.
—
2. Conformisme idéologique
Les créateurs peuvent être tentés de produire des œuvres qui plaisent aux institutions ou aux orientations politiques dominantes pour obtenir ou conserver leur financement.
Cela peut engendrer une “culture officielle”, politiquement correcte ou militante, au détriment de la diversité d’opinions.
—
3. Mauvaise allocation des ressources
Les fonds publics peuvent être mal distribués, favorisant certaines élites culturelles ou des cercles bien connectés, au lieu des artistes émergents ou des projets porteurs d’innovation.
Cela peut renforcer une “aristocratie culturelle” fermée sur elle-même.
—
4. Baisse de la qualité artistique
En l’absence de pression du marché ou d’un vrai public, certaines œuvres peuvent devenir hermétiques, prétentieuses ou auto-référentielles, sans souci de communication, d’émotion ou d’impact.
Certaines critiques parlent de “l’art pour les subventionnaires” plutôt que de “l’art pour le public”.
—
5. Conflits d’intérêt et clientélisme
Les mécanismes de subvention peuvent favoriser le copinage, les réseaux, ou des décisions subjectives qui ne reposent pas sur des critères artistiques solides.
—
6. Exclusion du marché
Les œuvres très subventionnées peuvent ne pas affronter le test du marché, et donc ne pas être confrontées aux goûts réels du public, ce qui peut les marginaliser encore davantage.
—
En résumé :
Subventionner les arts peut enrichir une société, mais mal encadré, cela peut créer un système fermé, dépendant, idéologisé et éloigné du public. C’est un débat classique entre la valeur artistique et la viabilité économique, entre autonomie créatrice et intervention publique.
ChatGPT