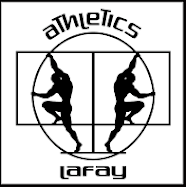Il est tout à fait possible que des Américains — qu’ils soient politiciens, intellectuels, militaires ou citoyens — soient encore captifs, consciemment ou non, du narratif stratégique forgé par Zbigniew Brzezinski.
🔹 Quel est ce « narratif » ?
Brzezinski, conseiller à la sécurité nationale sous Jimmy Carter, a laissé une marque durable sur la pensée géopolitique américaine, notamment à travers son livre Le Grand Échiquier (1997). Il y développe l’idée que :
• Le contrôle de l’Eurasie est essentiel à la domination mondiale.
• Les États-Unis doivent empêcher l’émergence d’un rival eurasien, notamment une alliance sino-russe ou un bloc indépendant en Asie centrale ou en Europe.
• Le monde est divisé entre puissances maritimes (comme les États-Unis) et puissances continentales (comme la Russie et la Chine), et il faut maintenir cet équilibre à l’avantage américain.
• Les instruments d’influence ne sont pas seulement militaires, mais aussi culturels, technologiques, économiques, etc.
🔹 En quoi cela peut-il rendre captif ?
Des générations de décideurs américains (et leurs alliés) ont été formées à voir le monde à travers cette grille de lecture géostratégique :
1. Méfiance structurelle envers la Russie et la Chine, indépendamment de leur comportement réel.
2. Priorité à la fragmentation de l’Eurasie (ex : soutien aux révolutions de couleur, à l’indépendance des anciennes républiques soviétiques, à l’OTAN en Europe de l’Est, etc.).
3. Vision impériale inconsciente : l’idée que l’Amérique doit dominer pour maintenir la stabilité globale.
🔹 Exemples d’actualité
• Guerre en Ukraine : l’idée que l’Ukraine ne doit surtout pas tomber dans l’orbite russe est typiquement brzezinskienne.
• Encerclement de la Chine (Quad, AUKUS, Taïwan, etc.) : cela reflète le désir de contenir une puissance continentale montante.
• Méfiance envers les BRICS : toute tentative de multilatéralisme hors des structures dominées par l’Occident est vue comme une menace.
🔹 Captivité ou héritage stratégique ?
Il est important de noter que ce n’est pas nécessairement une captivité consciente : pour beaucoup, cette vision est devenue le bon sens stratégique. C’est cela, justement, qui en fait une prison mentale difficile à remettre en question, surtout dans des cercles de pouvoir où le coût de la dissidence est élevé.
⸻
Plusieurs autres narratifs géopolitiques, idéologiques ou culturels ont profondément influencé la pensée et les décisions des États-Unis, à différents moments de leur histoire. Voici les plus marquants :
⸻
🔹 1. La doctrine Monroe (1823) – « L’Amérique aux Américains »
Narratif fondateur de l’hémisphère occidental : les puissances européennes doivent se tenir à l’écart du continent américain.
• Vise à protéger l’Amérique latine des influences coloniales européennes.
• Mais devient rapidement un prétexte à l’hégémonie américaine sur l’Amérique latine (ex : interventions militaires, soutien aux dictatures favorables aux intérêts US).
• Toujours vivant dans l’idée que les États-Unis sont les gardiens naturels du continent américain.
⸻
🔹 2. Le Destin manifeste (1845) – Mission divine de conquête
L’idée que les États-Unis ont une mission quasi religieuse d’étendre la civilisation, la liberté et la démocratie d’un océan à l’autre (et au-delà).
• A justifié la conquête de l’Ouest, les guerres contre le Mexique, et l’expansion jusqu’au Pacifique.
• Ressurgit à l’époque impériale (Philippines, Hawaï, etc.), puis dans l’interventionnisme du XXe siècle.
• Aujourd’hui, il survit dans l’idée de l’exceptionnalisme américain : les États-Unis seraient uniques, porteurs d’un rôle messianique mondial.
⸻
🔹 3. La doctrine Truman (1947) – Contenir le communisme
Narratif central de la Guerre froide : le monde est binaire (liberté vs tyrannie, capitalisme vs communisme) et les États-Unis doivent contenir l’expansion soviétique.
• Justifie des alliances (OTAN), des guerres (Corée, Vietnam), des coups d’État (Iran, Chili), etc.
• Cimente l’idée que la sécurité des États-Unis commence à l’étranger.
• A modelé des générations entières de diplomates, militaires, journalistes.
⸻
🔹 4. Le choc des civilisations (Samuel Huntington, 1993) – Après la Guerre froide
Après la chute de l’URSS, Huntington propose que les conflits futurs ne seront plus idéologiques ou économiques, mais culturels et religieux.
• Le monde est divisé en civilisations (occidentale, islamique, chinoise, etc.).
• Ce narratif renforce la méfiance envers l’islam, la Chine, la Russie.
• Très influent dans l’administration Bush après le 11 septembre, et dans la rhétorique du « monde libre » contre les « régimes autoritaires ».
⸻
🔹 5. Le narratif néoconservateur (années 2000) – Démocratie par la force
Popularisé sous Bush fils : les États-Unis ont le devoir d’exporter la démocratie, même par la guerre (Irak, Afghanistan).
• Reprend des éléments du destin manifeste et de l’exceptionnalisme.
• Résurgence de l’idée que les USA sont les gardiens de l’ordre mondial.
• Fortement critiqué après les échecs en Irak et en Afghanistan.
⸻
🔹 6. Le narratif techno-messianique (Silicon Valley) – Sauver le monde par la technologie
Plus récent : l’idée que les grandes plateformes et l’innovation (AI, data, biotech, etc.) peuvent résoudre tous les maux du monde (climat, pauvreté, santé).
• Les USA seraient les leaders légitimes de cette transformation globale.
• C’est un narratif doux, mais tout aussi impérial, souvent lié à des intérêts privés (Big Tech, transhumanisme, etc.).
⸻
🧠 En résumé
Brzezinski incarne l’un des narratifs géopolitiques les plus cohérents et durables, mais il s’inscrit dans un panthéon de visions du monde américaines. Ces narratifs :
• Se chevauchent souvent.
• Se recyclent selon les époques.
• Forment une matrice mentale collective difficile à remettre en cause.
⸻
ChatGPT
⸻
WAR is a massive racket. There are those who PROFIT and there are those who SACRIFICE.
— General Mike Flynn (@GenFlynn) November 24, 2024
To learn more, stream the film at:https://t.co/7W7HBc1YsM pic.twitter.com/qlWxKYYLhj
“WAR is a racket. It always has been. It is possibly the oldest, easily the most profitable, surely the most vicious. It is the only one international in scope. It is the only one in which the profits are reckoned in dollars and the losses in lives.
— Poetic Outlaws (@OutlawsPoetic) October 11, 2023
—Smedley Butler pic.twitter.com/NXSh1rWafw
WAR IS A RACKET
— Redpill Drifter (@RedpillDrifter) April 14, 2024
In light of all manufactured wars. I feel it's necessary to remind you of Major General Smedley Butler, a senior United States Marine Corps officer. He authored "War is a racket," which exposed the military industrial complex
Full audio version YOU MUST LISTEN pic.twitter.com/67XW94Zlzx
quand on examine les causes ou les prétextes des guerres... Molinari pic.twitter.com/ZoV88AH53R
— Collectif Antigone (@Collec_Antigone) August 22, 2022