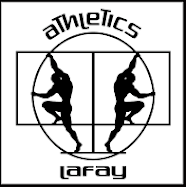« Accélérer le déploiement de projets stratégiques », « libérer le Québec de sa camisole de force bureaucratique », et réformer « le système » : François Legault a mis la table en ce début de session parlementaire.
— Patrice Roy (@PatriceRoyTJ) September 30, 2025
Le reportage de @VeroPrinceTV au #TJ18h pic.twitter.com/4RTazGNH1N
- Critique de la bureaucratie étatique :
- Legault mentionne vouloir "libérer le Québec de cette camisole de force bureaucratique" et accepte "de prendre des risques mesurés". Cela s'aligne avec la critique de Mises contre les bureaucraties qui, selon lui, freinent l'innovation et l'efficacité économique due à leur rigidité et leur manque d'incitations marchandes.
- Mises arguait que les bureaucraties publiques manquent d'efficacité parce qu'elles ne sont pas soumises à la pression concurrentielle du marché, un point que Legault semble vouloir adresser en demandant des cibles de réduction et en promouvant l'efficacité de l'État.
- Réduction de l'intervention de l'État et promotion de l'efficacité :
- Legault propose des coupes dans la fonction publique et des réformes pour accélérer les projets économiques, comme ceux d'Hydro-Québec. Cela reflète une tentative de réduire l'inefficacité perçue de l'État, un thème central chez Mises qui plaidait pour minimiser l'intervention gouvernementale au profit du marché.
- Cependant, contrairement à Mises, Legault ne semble pas viser une réduction radicale de l'État mais plutôt une réorientation vers des priorités économiques et stratégiques, ce qui indique un pragmatisme politique plutôt qu'une adhésion pure aux idées de l'école autrichienne.
- Focus sur l'économie de marché et les projets stratégiques :
- Legault parle d'accélérer le déploiement de projets économiques et énergétiques, inspirés par des modèles comme celui de Mark Carney au Canada. Cela peut être vu comme une tentative d'aligner l'action de l'État avec des objectifs market-driven, bien que cela reste dans un cadre étatiste, contrairement à la vision de Mises qui favorisait une économie entièrement libre.
- Mises aurait probablement critiqué l'idée d'un État accélérant des projets spécifiques, préférant que le marché détermine les priorités, mais il aurait pu approuver l'idée de réduire les barrières bureaucratiques qui entravent ces projets.
- Populisme et rhétorique :
- Les critiques sur X qualifient les actions de Legault de populistes, un terme que Mises aurait pu associer à des mouvements qui, bien que prônant des réformes, risquent de renforcer l'État plutôt que de le réduire. Mises était sceptique envers le populisme lorsqu'il menait à une expansion de l'État plutôt qu'à sa limitation.
- Étendue de la réforme : Mises plaidait pour une réduction drastique de l'État et une économie de marché libre, tandis que Legault propose des réformes dans un cadre où l'État reste un acteur central, mais plus efficient.
- Contexte nationaliste : Legault opère dans un cadre nationaliste québécois, axé sur des priorités locales comme l'énergie (Hydro-Québec) et la laïcité, alors que Mises était universaliste dans sa défense du libéralisme classique.
- Pragmatisme politique : Legault doit naviguer dans un environnement politique où des compromis sont nécessaires, contrairement à Mises qui proposait des solutions idéologiques pures.
Il y a un parallèle dans la critique de la bureaucratie et dans l'appel à une plus grande efficacité économique, mais Legault s'inscrit dans un pragmatisme politique qui diffère fondamentalement de l'idéalisme de Mises. Legault cherche à réformer l'État pour qu'il soit plus efficient dans ses interventions, tandis que Mises aurait préféré minimiser ces interventions au profit d'une économie de marché libre. Ce parallèle montre comment des idées économiques peuvent être adaptées, mais aussi transformées, dans des contextes politiques spécifiques.
Grok
...Ce furent les idées des économistes classiques.. Mises pic.twitter.com/52WAF7QJT9
— Collectif Antigone (@Collec_Antigone) December 6, 2018
Pire que SAAQclic. En raison des mauvais placements effectués sous Pierre Fitzgibbon, le gouvernement @francoislegault a dû injecter l’an dernier près de 1,5 milliard $ dans le Fonds de développement économique pour couvrir les mauvaises créances et le déficit. https://t.co/AZ1XH9k3w7 pic.twitter.com/XfgLfupday
— Michel Girard (@migirard) October 2, 2025
5,1 MILLIARDS en 6 ans : Les pertes du Fonds de développement économique du Québec administré par Investissement Québec.
— Joanne_Marcotte (@Joanne_Marcotte) October 2, 2025
L’échec foudroyant de @francoislegault: Avoir fait confiance démesurément à Fitzgibbon et à @cdube_sante.
Voilà son legs. https://t.co/ADRO7h7V4j
UN TEXTE ASSOMMANT - Fonds de développement économique du Québec. Le PLQ, le PQ: ils en pensent quoi du dirigisme étatique en économie???
— Joanne_Marcotte (@Joanne_Marcotte) October 3, 2025
- Prêts en souffrance: plus que doublé pour atteindre 1,4 milliard, soit 25 % de la valeur de l’argent prêté (5,6 milliards).
- Près de la…
Voici une chronologie claire des enquêtes menées au Québec visant Pierre Fitzgibbon, avec les dates et les résultats (ou l’effet politique) pour chacune :
Chronologie des enquêtes et résultats
Novembre 2018 → rapport déposé (juin 2019) — Actions dans Héroux-Devtek
Enquête sur des intérêts détenus par M. Fitzgibbon dans Héroux-Devtek (fournisseur important). Rapport de la commissaire déposé en 2019. (Le Journal de Montréal)Avril 2019 → rapport déposé (fin oct. 2020) — Actions dans Move Protéine
Enquête sur des participations qu’il détenait (liée à des nominations à Investissement Québec). Rapport déposé fin 2020. (Le Journal de Montréal)Janvier 2020 → rapport déposé (déc. 2020) — Omissions déclaratives / non-vente d’intérêts
Enquête concernant l’omission de déclarer toutes ses participations et le fait de ne pas avoir vendu certaines actions liées à l’État. Rapport publié en décembre 2020 (blâme / reproches dans le dossier). (Le Journal de Montréal)Mars 2021 → rapport déposé (2 juin 2021) — Immervision et White Star Capital — conséquence politique : démission temporaire
La commissaire a recommandé la suspension (lié à ses intérêts dans Immervision et White Star). Fitzgibbon a démissionné de son poste ministériel le 2 juin 2021; il est revenu après la vente de ses actions. (Le Journal de Québec)Octobre 2022 → rapport (23 fév. 2023) — Aide publique (24 M$ / LMPG / Lumenpulse)
Enquête portée sur un investissement public de ~24 M$ envers LMPG (liens avec un ancien mandataire de sa fiducie). Résultat : la commissaire a conclu qu’il n’y avait pas de manquement pour cette affaire (il a été blanchi dans ce dossier en février 2023). (Le Journal de Montréal)Décembre 2022 → rapport (31 mai 2023) — Partie de chasse au faisan (île privée)
Plainte et enquête sur une chasse à laquelle il a participé sur une île appartenant à gens d’affaires subventionnés. Résultat : la commissaire a jugé qu’il n’avait pas commis de manquement, mais a lancé un appel à la prudence et recommandé des mesures pour prévenir l’apparence de conflit d’intérêts. (Le Journal de Québec)
—
Bilan synthétique
- Nombre d’enquêtes officielles : au moins 6 enquêtes menées par la Commissaire à l’éthique et à la déontologie depuis son entrée en politique (2018→2023). (Le Journal de Québec)
- Résultats : plusieurs dossiers l’ont blâmé ou posé problème (notamment en 2020 → ventes d’actions), l’ont forcé à démissionner temporairement en juin 2021, mais certaines enquêtes ultérieures l’ont blanchi (p. ex. LMPG / chasse au faisan en 2023). (Le Journal de Québec)
—
ChatGPT
___
Il y a plusieurs posts sur X (anciennement Twitter) qui mentionnent “Fitzgibbon” en lien avec le WEF (World Economic Forum). La grande majorité de ces posts font référence à Pierre Fitzgibbon, le ministre québécois de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, souvent critiqué pour ses liens présumés avec le WEF, ses voyages à Davos ou son rôle dans des décisions économiques perçues comme alignées sur les agendas du Forum (comme les investissements verts ou les partenariats internationaux). Ces discussions sont principalement en français, dans un contexte politique québécois et canadien, et datent des derniers mois (jusqu’en août 2025).
Voici un résumé des thèmes récurrents basés sur une recherche récente :
• Critiques politiques : Fitzgibbon est accusé d’être un “agent” ou un “infiltré” du WEF, de “vendre le Québec” au Forum, ou de suivre ses directives pour des projets comme les éoliennes ou les investissements dans des entreprises liées au WEF (ex. : Northvolt).
• Liens avec d’autres figures : Souvent associé à François Legault, Justin Trudeau ou d’autres politiciens canadiens vus comme pro-WEF.
• Exemples concrets : Des posts évoquent ses visites au WEF pour “chercher des ordres” ou pour promouvoir des agendas mondiaux au détriment des intérêts locaux.
Exemples de posts récents :
• Un utilisateur (@ReseauAntiSpin) commente ironiquement un post sur une décision politique en écrivant : “Pierre WEF Fitzgibbon…” (15 août 2025).
• Un autre (@AlexCharette17) liste des politiciens impliqués avec le WEF, incluant Fitzgibbon : “Trudeau, Legault, Fitzgibbon, Joly, Freeland, Sabia et plus font tous partie du WEF.” (29 juin 2025).
• @ElasticPlastic9 mentionne : “Northvolt c’est arrivé après une visite au WEF par Fitzgibbon.” (2 mai 2025).
• @LavalleeYvon4 : “Fitzgibbon a été au WEF à plus d’une reprise pour aller chercher les ordres, des WEFeux comme les autres.” (26 mars 2025).
• Plusieurs posts critiquent sa successeure, Christine Fréchette, en la comparant à lui : “Merci de confirmer que vous êtes une corrompue du WEF comme l’est votre prédécesseur Fitzgibbon.” (29 janvier 2025).
Grok
 source —> https://www.journaldemontreal.com/
source —> https://www.journaldemontreal.com/…
Les philosophes, sociologues et économistes du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle ont formulé un programme politique qui, en politique sociale, servit de guide, tout d'abord pour l'Angleterre et les États-Unis, ensuite pour le continent européen, et finalement aussi pour toutes les autres régions habitées du globe. On ne réussit cependant nulle part à l'appliquer dans sa totalité. Même en Angleterre, qu'on a dépeint comme la patrie du libéralisme et comme le modèle du pays libéral, les partisans des politiques libérales n'ont jamais réussi à faire entendre toutes leurs revendications. Dans le reste du monde, seules certaines parties de ce programme furent adoptées, tandis que d'autres, tout aussi importantes, furent soit rejetées dès le départ, soit écartées après peu de temps. Ce n'est qu'en forçant le trait que l'on peut dire que le monde a traversé une époque libérale. On n'a jamais permis au libéralisme de se concrétiser pleinement.Néanmoins, aussi brève et limitée que fut la suprématie des idées libérales, elle fut suffisante pour changer la face du monde. Il se produisit un formidable développement économique. La libération des forces productives de l'homme multiplia les moyens de subsistance. A la veille de la [Première] Guerre Mondiale (qui fut elle-même la conséquence d'une longue et âpre bataille contre l'esprit libéral et qui inaugura une ère d'attaques encore plus virulentes dirigées contre les principes libéraux), le monde était bien plus peuplé qu'il ne l'avait jamais été, et chaque habitant pouvait vivre bien mieux qu'il n'avait jamais été possible au cours des siècles précédents. La prospérité que le libéralisme avait créée avait considérablement réduit la mortalité enfantine, qui constituait le lamentable fléau des périodes précédentes, et avait allongé l'espérance de vie moyenne, grâce à l'amélioration des conditions de vie.
Cette prospérité ne concernait pas seulement une classe particulière d'individus privilégiés. A la veille de la [Première] Guerre Mondiale, l'ouvrier des nations industrialisées d'Europe, des États-Unis et des colonies anglaises vivait mieux et avec plus d'élégance que le noble d'un passé encore proche. Il pouvait non seulement manger et boire comme il le voulait, mais il pouvait aussi donner une meilleure éducation à ses enfants et prendre part, s'il le désirait, à la vie intellectuelle et culturelle de son pays. De plus, s'il possédait assez de talent et d'énergie, il pouvait sans difficulté monter dans l'échelle sociale. C'est précisément dans les pays qui appliquèrent le plus loin le programme libéral que le sommet de la pyramide sociale était composé en majorité non pas d'hommes qui avaient bénéficié, depuis le jour de leur naissance, d'une position privilégiée en vertu de la richesse ou de la position sociale élevée de leurs parents, mais d'individus qui, dans des conditions défavorables et initialement dans la gêne, avaient gravi les échelons par leurs propres forces. Les barrières qui séparaient autrefois les seigneurs et les serfs avaient été supprimées. Il n'y avait désormais plus que des citoyens bénéficiant de droits égaux. Personne n'était handicapé ou persécuté en raison de sa nationalité, de ses opinions ou de sa foi. Les persécutions politiques et religieuses avaient cessé et les guerres internationales commençaient à être moins fréquentes. Les optimistes saluaient déjà l'aube d'une ère de paix éternelle
Bureaucratie et totalitarisme
Nous aurons l'occasion d'indiquer dans les pages qui suivent que la bureaucratie et ses méthodes remontent à la plus haute antiquité et qu'on les trouve dans l'appareil administratif de tous les États dont la souveraineté s'étend sur des territoires immenses. Les Pharaons de l'Égypte ancienne et les Empereurs de Chine édifièrent une lourde machine bureaucratique et tous les chefs d'État après eux suivirent leur exemple. La féodalité fut une tentative qui prétendait se passer des hommes et des méthodes bureaucratiques dans l'organisation politique de vastes territoires. L'échec en fut retentissant. Elle aboutit à un émiettement total de l'unité politique antérieure et sombra dans l'anarchie. Les seigneurs féodaux, à l'origine simples officiers et sujets du pouvoir central, devinrent en fait des seigneurs indépendants, sans cesse en lutte les uns contre les autres, bravant le roi, la justice et les lois. Depuis le XVe siècle, dans toute l'Europe, le principal souci des rois fut de faire plier la superbe de leurs vassaux. L'État moderne est bâti sur les ruines de la féodalité. Il a remplacé la suprématie d'une multitude de princes et de comtes par une organisation bureaucratique des affaires publiques.Les rois de France furent les pionniers de cette révolution. Alexis de Tocqueville a montré comment la dynastie des Bourbons s'employa obstinément à supprimer l'autonomie des grands vassaux et des oligarchies qui s'étaient constituées au sein de la noblesse. A cet égard, la Révolution française n'a fait qu'achever l'œuvre commencée par la monarchie absolue. Elle abolit l'arbitraire royal, établit la primauté de la loi en matière administrative et restreignit le nombre des affaires soumises au pouvoir discrétionnaire des fonctionnaires. Elle ne supprima pas l'organisation bureaucratique, elle lui donna seulement une base légale et constitutionnelle. Le régime administratif du XIXe siècle en France fut une tentative pour dompter, autant qu'il était possible par la loi, l'arbitraire des bureaucrates. Il servit de modèle à toutes les autres nations libérales — en dehors de la sphère du Common Law anglo-saxon — qui voulurent établir la suprématie de la loi et de la légalité dans la conduite des affaires publiques.
On ne sait pas assez que le système administratif prussien, tant admiré par les défenseurs de l'omnipotence de l'État n'était à l'origine qu'une copie des institutions françaises. Frédéric II le « Grand », importa de France non seulement les méthodes, mais encore le personnel qui devait les appliquer. Il remit l'administration de la régie et des douanes à un corps de plusieurs centaines de fonctionnaires français émigrés et nomma un Français directeur général des Postes, un autre président de l'Académie. Les Prussiens du XVIIIe siècle avaient, pour refuser à la bureaucratie le qualificatif de prussienne, de meilleures raisons que n'en ont les Américains d'aujourd'hui lorsqu'ils lui dénient tout caractère américain.
Dans les pays du Common Law anglo-saxon, le moule juridique dans lequel s'écoulait la vie administrative différait beaucoup de celui des nations de l'Europe continentale. Anglais et Américains étaient les uns et les autres parfaitement convaincus que leur système leur assurait la protection la plus efficace contre les empiètements de l'arbitraire administratif. Toutefois, l'expérience des dernières décades a montré clairement que les précautions légales ne sont pas assez fortes pour résister à des courants que vient renforcer une idéologie puissante. Le mythe populaire de l'intervention de l'État en matière économique et les idées socialistes ont sapé les digues érigées par vingt générations d'Anglo-Saxons contre l'arbitraire gouvernemental. De nombreux intellectuels et des organisations de masse agricoles et ouvrières, qui réunissent un grand nombre d'électeurs, dénigrent le système de gouvernement traditionnel en Amérique, considéré comme « ploutocratique », et souhaitent l'introduction des méthodes russes qui n'accordent à l'individu aucune protection contre le pouvoir discrétionnaire de l'administration.
Le totalitarisme est bien autre chose que la simple bureaucratie. C'est la soumission totale de l'individu, dans le travail et dans le loisir, aux ordres des dirigeants et des fonctionnaires. Il réduit l'homme à n'être qu'un rouage dans un mécanisme de contrainte et de coercition qui embrasse tous les aspects de la vie individuelle. Il oblige l'individu à renoncer à toute activité que l'État n'approuve pas. Il transforme la société en une armée du travail admirablement disciplinée, disent les défenseurs du socialisme, en un bagne, répliquent ses adversaires. En tout cas, il rompt de façon radicale avec le mode de vie auquel les nations civilisées étaient traditionnellement attachées. Avec lui l'humanité ne se contente pas de retourner au despotisme oriental sous lequel, ainsi que l'a noté Hegel, un seul homme était libre et tous les autres esclaves, car les monarques asiatiques n'intervenaient pas dans la vie quotidienne de leurs sujets. L'agriculteur indépendant, le pasteur, l'artisan gardaient un champ d'activité que le roi et ses satellites ne venaient pas troubler et jouissaient d'une certaine autonomie dans la conduite de leur maison et de leur famille. Il en va autrement dans le socialisme moderne, totalitaire au sens strict du mot. Il tient en bride l'individu de la naissance à la mort. A toute heure, le « camarade » est tenu d'obéir implicitement aux ordres venus de l'autorité suprême. L'État est pour lui à la fois le gardien et l'employeur. L'État détermine son travail, sa nourriture et ses plaisirs. Il lui dicte ce qu'il doit penser et ce à quoi il doit croire.
La bureaucratie joue un rôle essentiel dans l'exécution des plans. Mais on a tort d'imputer aux bureaucrates pris individuellement les vices du système. Les hommes et les femmes qui occupent les bureaux et les administrations n'en sont pas responsables. Ils sont autant que tous victimes du nouveau mode de vie. C'est le système qui est mauvais, et non pas les sous-ordres qu'il utilise. Un État ne se dirige pas sans administration et sans méthodes bureaucratiques. Et comme la collaboration sociale, pour être efficace, nécessite un gouvernement, une certaine dose de bureaucratie est indispensable. Ce dont nous souffrons, ce n'est pas tant de la bureaucratie elle-même que de son intrusion dans tous les domaines de la vie et de l'activité humaines. La lutte contre les empiètements de la bureaucratie est essentiellement une révolte contre la dictature totalitaire. C'est par un abus de langage que l'on appelle la lutte pour la liberté et la démocratie une lutte contre la bureaucratie.
Cependant ce n'est pas sans raison qu'on attaque de toutes parts les méthodes et les procédures bureaucratiques. Car leurs imperfections permettent de voir les défauts essentiels d'un programme socialiste ou totalitaire. Une étude approfondie du problème de la bureaucratie doit nous nous permettre de découvrir pourquoi les utopies socialistes ne sont pas viables et aboutissent nécessairement, quand on en poursuit la réalisation, non seulement à un appauvrissement général, mais à la dissolution de la société et au chaos. Elle constitue une préparation excellente à l'étude des deux systèmes d'organisation sociale que sont le capitalisme et le socialisme.
— Collectif Antigone (@Collec_Antigone) September 25, 2025